|
L’ACCIDENT
DE DECOMPRESSION
Le fléau du XIXème
Siècle
1.
Introduction
|
La
plongée « pieds lourds » s’est développée dès le
milieu du XIXème siècle afin de récupérer les
cargaisons des navires coulés près des côtes et
d’effectuer des travaux sous-marins divers. Jusqu'au milieu
du siècle dernier, la maladie de décompression était un mal
très mystérieux qui frappait de très nombreux
scaphandriers. Ce n'est qu'en 1878, après de nombreuses expérimentations
animales, que Paul Bert apporte la preuve expérimentale que
la maladie à pour origine la formation de bulles d’azote
qui sont observées lors de l’autopsie de ces animaux.
|
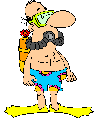 |
|
Mais
la seule règle reconnue jusqu’à la fin du siècle est de
remonter «lentement». Ce n’est qu’en 1896 que Haldane
publie les premières tables de plongée.
L’accident de décompression reste l’ennemi mortel
du plongeur sportif, pouvant frapper quelle que soit la
profondeur ou le niveau technique. Bien que des recherches sur
les mécanismes et les causes soient menées depuis plus
d’un siècle, le corps médical n’a pas encore découvert
la totalité des modes de déclenchement de l’apparition des
bulles d’azote dans les tissus lors de la remontée.
2-
Rappel
Pour
comprendre tous les mécanismes de l’accident de décompression,
nous aurons besoin des notions physiques suivantes :
«A température
constante, le volume d’un gaz est inversement
proportionnel à la pression qu’il subit». Il en découle
la formule suivante : P x V =Cste
Cette loi explicite le grossissement des bulles lorsque la
pression diminue.
«A température
donnée et à saturation, la quantité de gaz dissous dans
un liquide est proportionnelle à la pression exercée par
ce gaz sur le liquide».
Cette loi explicite l’apparition de bulles dans les tissus
du plongeur.
Bien
que 70% du corps humain soit composé d’eau, toutes les
parties du corps ne se comportent pas de la même manière
vis à vis de la dissolution de l’azote. Notre corps a été
modélisé en compartiments (appelés auparavant
tissus comme on peut encore le lire sur la documentation de
certains ordinateurs de plongée). Chaque compartiment est
caractérisé par une période qui détermine la vitesse de
saturation ou de désaturation de cette partie du corps. A
tout moment le coefficient de sursaturation (Sc :
tension d’azote dissous divisé par la pression absolue)
ne doit pas dépasser le coefficient de sursaturation
critique pour chacun des compartiments. Sinon, il y a
formation de bulles.
Auteur:
Stéphane
ROCHON
3-
Mécanismes
3. Mécanismes
L’azote
est mis en contact avec le sang lors de la respiration, il
s'y accumule, et par son intermédiaire se diffuse dans
toutes les autres parties du corps. La quantité d’azote
dissous dépend de la pression partielle, donc de la
profondeur, de la durée d'exposition et de son coefficient
de solubilité dans chacune des parties du corps. Lorsque la
pression augmente, la quantité de gaz dissous augmente également.
Lorsque la pression diminue, les liquides doivent éliminer
une partie de ce gaz. Seul l’azote intervient dans le mécanisme
de l’accident de décompression car il représente 80% de
l’air respiré.
Lorsque
le plongeur se dirige vers la surface, la pression de
l’air qu’il respire diminue, plaçant ainsi certains
tissus de son corps en état de sursaturation. Ces tissus
vont désaturer par l’intermédiaire du sang qui libère
le surplus d’azote au niveau des poumons. Si on dépasse
les possibilités d’épuration pulmonaire, des microbulles
peuvent s’accumuler dans certaines parties du corps et créer
des lésions graves, et bien trop souvent fatales.
Une
désaturation trop rapide d'un gaz dissous dans un liquide
provoque l'apparition de microbulles au sein même du
liquide et non plus seulement à la surface de contact des
deux fluides. Si ces microbulles s'amalgament entre elles et
forment des bulles mesurables, elles sont soumises à la loi
de Mariotte qui provoque une augmentation de leur taille au
fur et à mesure de la diminution de pression du gaz.
Le
lieu de formation des bulles est encore incertain. On est
cependant pratiquement sûr qu'il est extracellulaire et de
nombreux auteurs privilégient l'intérieur des petits
vaisseaux, artérioles, capillaires ou veinules. Ces bulles
se forment à partir d'une phase gazeuse préexistante, les
noyaux gazeux. L'origine de ces germes fait l'objet de
plusieurs hypothèses ne s'excluant pas l'une l'autre. En
voici deux :
- Ils
peuvent se former en tout point d'un liquide où se
produit une variation de tension, et cela d'autant plus
facilement que le liquide est hétérogène. Ces noyaux
gazeux auraient pour origine les frottements tissulaires
provoqués par le travail musculaire et seraient situés
dans les espaces intercellulaires.
- Il
peut s'agir de microbulles de gaz carbonique présentes
sur les parois des vaisseaux qui constitueraient les
sites d'adsorption de l'azote.
Les
forces intermoléculaires qui permettent de maintenir le
noyau gazeux en place se font de plus en plus faibles au
point de permettre aux noyaux sphériques de se détacher
des parois cellulaires pour former des microbulles. Si le phénomène
a eu lieu dans un vaisseau, la bulle circulante est née.
Lorsqu’une
microbulle se forme, sa pression interne est supérieure à
la pression ambiante. La bulle est donc très fragile et a
tendance à disparaître spontanément tant que son diamètre
n'est pas supérieur à un dixième de millimètre. Par
contre, si la pression ambiante continue à diminuer, il y a
apparition de nouvelles bulles par libération de noyaux
gazeux selon le mécanisme décrit dans le paragraphe précédent.
La bulle va croître en piégeant l'azote dissous qui
l'entoure.
La
croissance d'une bulle est donc directement dépendante de
l'importance de la baisse de la pression ambiante et de la
masse de gaz dissous qui peut l'alimenter jusqu'à ce que l'état
d'équilibre soit atteint.
Le
devenir des bulles dépend de leur site de formation. Si
elles se sont formées dans un tissu, elles peuvent rester
stationnaires, et absorber tout le gaz qui les entoure.
Elles ont une action mécanique locale. Par contre les
bulles circulantes, générées principalement dans le réseau
veineux suite à l’évacuation de celles-ci par les
tissus, passent dans les veines caves puis dans le coeur
droit. Dans ce cheminement, le diamètre des vaisseaux s'est
accru et rien n'a arrêté la progression des bulles. Au-delà,
dans la circulation artérielle pulmonaire, le calibre des
vaisseaux se rétrécit et l'élément déterminant l'évolution
des bulles est l'importance du dégazage provenant des différents
compartiments de l'organisme.
Si
les bulles sont peu nombreuses et de petit diamètre,
situation habituelle et normale dans toute décompression,
elles sont éliminées au niveau alvéolaire par diffusion
ou par passage gazeux direct. Par contre, si le débit
d'arrivée dans les poumons de ces bulles circulantes, même
de petit volume, est supérieur à la capacité d'élimination,
les bulles encombrent la circulation, et grossissent dans
les capillaires pulmonaires.
Ces
bulles vont avoir, sur le lieu même de leur formation,
une action de compression des tissus avoisinants. Les
vaisseaux sanguins sont particulièrement exposés et
cette compression qui peut aller jusqu'à l'interruption
de la circulation sanguine.
Elles
peuvent aussi comprimer des filets nerveux ce qui
explique, en partie, les violentes douleurs articulaires.
Leur action au niveau des tendons peut aussi être
douloureuse.
Les
bulles d'origine veineuse obturant la circulation
capillaire pulmonaire ont des conséquences directes (au
niveau pulmonaire et après) non négligeables, qui
expliquent l’apparition de certains accidents
neurologiques. Localement, le ralentissement
microcirculatoire pulmonaire est responsable d'une hypoxie
par diminution des échanges alvéolo-capillaires.
Mais
ces bulles migratrices d'origine veineuse sont
susceptibles de se bloquer bien avant le système artériel
pulmonaire car le système de drainage de la moelle épinière
présente en particulier des « siphons » propices à un
blocage. Les bulles se forment dans les graisses de la
moelle épinière et se bloquent dans ses veines. On parle
d’accidents de type neurologique bas ou médullaires
(60% des accidents de décompression).
Quant
aux bulles artérielles, elles peuvent se bloquer dans le
réseau circulatoire, ce qui explique certains accidents cérébraux,
cardiaques ou de l'oreille interne. On parle d’accidents
de type neurologique haut.
Auteur:
Stéphane
ROCHON
4-
Symptômes
Voici
les nombreux symptômes qui peuvent apparaître lors d’un
accident de décompression, la sensation de fatigue étant
toujours ressentie :
- Asthénie
(sensation de fatigue intense),
- Incapacité
d'uriner,
- Démangeaisons
cutanées : cloques, puces et moutons,
- Douleur
articulaire vive allant en empirant : bends,
- Vertiges
et nausées : accident du labyrinthe (oreille interne),
- Paralysies
et paresthésies (perte de sensibilité) des membres,
- Détresse
ventilatoire (perturbation de la fonction ventilatoire
par l'amas bullaire),
- Perte
ou altération de fonctions sensorielles (ouïe, parole,
toucher...),
- Perte
de motricité (souvent latéralisée) par atteinte de
l'encéphale,
- Infarctus
du myocarde : arrêt cardiaque.
4.1
Accidents cutanés
Il
s'agit de démangeaisons localisées ou généralisées. Ces
accidents sont dus au dégazage de l’azote dans les
capillaires ou dans la graisse sous-cutanée. On en trouve
de deux sortes :
- Les puces
: dues à la présence de bulles dans les capillaires présents
dans la peau, se traduisant par des fourmillements et
des plaques rouges éruptives.
- Les moutons
: il s'agit d'un emphysème sous-cutané dû à la
formation de bulles dans le tissu sous-cutanée. Les
moutons se présentent sous la forme de cloques donnant
la sensation de neige crépitante à la palpation.
Ces
accidents sont dus à la présence de bulles dans les extrémités
osseuses, au niveau des articulations qui travaillent le
plus. Ils se traduisent par une simple gêne, une sensation
de corps étranger ou une douleur d'intensité variable et
apparaissent peu de temps après le retour en surface.
Les
bends touchent en ordre de fréquence décroissant : l'épaule,
le genou, la hanche, le poignet et la cheville. Cette
douleur résiste aux antalgiques mais disparaît assez
rapidement lors de la recompression. La guérison est sans séquelles.
Si ces douleurs ne sont pas traitées, elles s'estompent
spontanément au bout de 24 à 48 heures. Cependant, la récidive
est presque inévitable et peut entraîner de très graves nécroses
osseuses.
Ils
sont dus à la formation de bulles dans les vaisseaux
irriguant l'appareil cochléo-vestibulaire (audition et équilibration)
ou dans les liquides lymphatiques baignant ce même
appareil. Ils se traduisent par :
- un
état nauséeux (mal de mer) : chose banale sur un
bateau et pouvant faire passer à côté du diagnostic,
- des
vertiges vrais,
- des
vomissements,
- des
déficits auditifs attribués à tort à des difficultés
d'équilibration,
- des
acouphènes (bruit de fond),
- un
équilibre instable.
Ils
peuvent donc être la cause d'erreurs de diagnostic
de la part du plongeur ne le conduisant pas à s'orienter
immédiatement vers un caisson de recompression. Ces
accidents se caractérisent par l’absence de douleur à
l’oreille et par un tympan normal à l’otoscopie (différences
avec le barotraumatisme de l’oreille). Ils engagent
l'avenir du plongeur du fait du risque de séquelles définitives
sur l'audition essentiellement.
Les
accidents neurologiques qui sont l'apanage du plongeur
autonome. Ils sont de deux types (avec combinaison
possible), médullaires et cérébraux. Les accidents
médullaires, causés par les bulles présentes dans la
moelle épinière se reconnaissent par les troubles moteurs
suivants :
- monoplégie
(ou paralysie isolée) d'un membre ou d'un segment de
membre.
- paraplégie,
paralysie de la moitié inférieure du corps. C'est
l'accident neurologique typique de l'accident de décompression.
Cette paraplégie s'accompagne de souvent de rétention
urinaire.
Les
accidents cérébraux, causés par la présence de bulles
dans l’irrigation du cerveau, se reconnaissent par les
troubles moteurs suivants :
- hémiplégie,
paralysie de la moitié verticale du corps.
- tétraplégie
ou quadriplégie, paralysie des quatre membres avec ou
sans atteinte respiratoire.
- mort
par atteinte massive des zones de commandes vitales.
Ces
troubles moteurs se caractérisent par une difficulté plus
ou moins complète à mobiliser un membre. Ils peuvent être
évolutifs, une monoplégie peut évoluer vers une hémiplégie.
Ils sont toujours très graves en raison de leur
localisation et des désordres qui les accompagnent. Une
douleur vive au niveau du rachis ou à la ceinture, des
fourmillements ou picotements sur les membres inférieurs
(paresthésie) sont des signes révélateurs de l’accident
neurologique.
La
bulle dans une artère coronaire est source d'infarctus du
myocarde avec douleur rétrosternale, c’est-à-dire derrière
le sternum.
Les
accidents pulmonaires sont provoqués par l’obstruction de
l'artère pulmonaire ou de l'une de ses branches. Cela se
traduit par un état asphyxique plus ou moins aigu.
L'apparition de ces problèmes doit faire éliminer le
diagnostic de surpression pulmonaire et son éventuel
pneumothorax.
Au
fur et à mesure de l'installation des blocages
circulatoires par les manchons bullaires d'azote, dans les
minutes et les heures qui suivent le début de l'accident,
un certain nombre de mécanismes de défenses se mettent en
place. Il s'agit d'un ensemble de réactions de
l’organisme à la présence des bulles d’azote dont
voici l'essentiel :
- Réaction
de lutte contre le corps étranger que représente la
bulle d’azote de la part des leucocytes (globules
blancs) qui l’entourent d'un réseau de fibrine,
- Libération
d'histamine (processus inflammatoire),
- Réaction
propre au fluide sanguin lui même : plus de circulation
et d'oxygénation et donc formation d'agrégat
plaquetto-cellulaires (même phénomène que la
coagulation).
Les
bulles, ainsi entourés, ne sont plus accessibles pour un
traitement par dissolution simple. Les anoxies et les
nécroses des tissus non irrigués se développent et
les lésions conséquentes deviennent irréversibles.
Cette série de réactions est normale puisque l'organisme
considère ces bulles comme des corps étrangers. Ce sont
par conséquent des processus de défense qui s'organisent
et qui sont très vite mis en oeuvre, mais leur évolution
va aggraver l'anoxie des tissus touchés.
Les
accidents de décompression se produisent généralement après
le retour en surface avec un certain temps de latence. Ils
sont d'autant plus graves qu'ils surviennent dans un délai
précoce :
- dans
les 30 minutes qui suivent la plongée, pour 50 % des
accidents,
- dans
l'heure qui suit le plongée, pour 85 % des accidents,
- dans
les 3 heures qui suivent la plongée, pour 95 % des
accidents,
- dans
les 6 heures qui suivent la plongée, pour 99 % des
accidents,
- il
existe des cas plus tardifs allant jusqu'à 12 heures
après la plongée.
On
distingue les accidents :
- bénins
: puces, moutons,
- graves
: neurologiques, articulaires, cochléo-vestibulaires,
cardiaques, pulmonaires.
Leur
fréquence est la suivante :
- 68
% neurologiques,
- 29
% ostéo-articulaires,
- 3
% pulmonaires et coronaires.
Voici
les statistiques pour la France du nombre de personnes qui
ont fait un séjour en caisson hyperbare selon les régions
:
| Région |
Accidents
(par an) |
| Aquitaine |
5 |
| Corse |
30 |
| Marseille |
40 |
| Toulon |
60 |
| Total |
200 |
La
moyenne d’âge est de 30 à 35 ans, 90% sont des hommes et
30% sont des moniteurs ou des plongeurs professionnels.
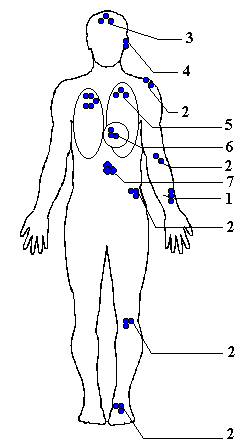 |
1-Réactions
cutanées : puces et moutons.
2-Douleurs
ostéo-articulaires et
musculaires : bends.
3-Accidents
cérébraux.
4-Troubles
de l'oreille interne.
5-Troubles
respiratoires.
6-Troubles
cardiaques.
7-Accidents
médullaires (moelle épinière).
|
Auteur:
Stéphane
ROCHON
5-
Causes
La
majorité des plongeurs confirmés sont persuadés que les
accidents de décompression n’apparaissent généralement
que dans les deux cas suivants :
- une
plongée longue (supérieure à 60 minutes) pour des
profondeurs moyennes (20 mètres),
- une
plongée profonde avec une durée supérieure à ce qui
est préconisé par la courbe de sécurité.
Ce
n'est que depuis ces quelques années qu'une nouvelle notion
a été introduite dans le langage du plongeur : l'accident
« immérité ». Il s’agit d’accidents consécutifs
à des procédures de désaturation considérées comme
techniquement irréprochables. En réalité,
l'analyse soigneuse des circonstances de tous ces accidents
a permis la mise en évidence de facteurs que l'on a très
rapidement considérés comme suffisants pour être à
l'origine d'un dégazage. C’est ce type d’accidents qui
est à l'origine de la rénovation des tables de plongée de
la Marine Nationale.
Bien
que les paliers de désaturation demeurent une nécessité
absolue, leur rigueur d'exécution échappe à certains
plongeurs et leur non-respect représente la première
grande cause des accidents de décompression.
Certains
plongeurs débutants ignorent leur existence et plongent
sans encadrement ou, au contraire, chez certains plongeurs
confirmés, l’accoutumance et les petites fautes de plongée
sans conséquences sont autant d'incitations à négliger
les règles de sécurité.
L’utilisation
des tables de plongée implique la connaissance de la
profondeur maximale et la durée de la plongée. Il peut y
avoir, en particulier dans le cadre des plongées
d'exploration où le début de la remontée est quelquefois
mal précisé, une ambiguïté provenant du fait que le
plongeur pense que le temps passé à remonter lentement le
long d’un tombant n'a pas à être inclus dans la durée
de la plongée. En réalité, la saturation de certains
compartiments se poursuit et justifie des durées de paliers
plus longues que celles qui vont être effectuées.
Certains
profondimètres mécaniques, subissant l’usure du temps et
des éléments, n’indiquent plus forcement la profondeur
maximale avec une grande précision. L’erreur de lecture
peut avoir des conséquences dramatiques alors que le
plongeur a respecté les tables.
Les
paliers peuvent subir une approximation en temps ou en
profondeur, en particulier en cas de houle pour le palier de
3 mètres lorsque ce dernier se fait en pleine eau. Il ne
faut pas hésiter à descendre un peu et à majorer la durée
dans des conditions difficiles.
Le
palier peut être écourté ou non fait par suite d'un
incident : malaise, panne d'air ou de matériel, panique,
mauvais contrôle du gilet gonflable, plongeur
insuffisamment lesté.
En
l'état actuel des statistiques d'accidents, il est
impossible de dire si l'utilisation aveugle et croissante de
ces appareils accroît le risque d'accident de décompression.
Ce qui est sûr, c'est que l'algorithme utilisé calcule
pour le plongeur utilisateur un profil de désaturation
moyennement ajusté et non exactement, comme il le croit, à
l'état de saturation que l'appareil a évalué en
permanence pendant la plongée en fonction des couples
pression/durée. Dans l'optique d'une optimisation de la durée
des paliers par rapport à la durée de la plongée, c'est
bien entendu l'idéal. Mais en l'état actuel de la
conception de ces ordinateurs, le risque d'accident existe,
bien que difficilement quantifiable, car les paramètres de
l'algorithme sont ceux qui ont été validés pour un
plongeur moyen, provenant d’une étude statistique. En réalité,
l'expérience actuelle montre que le plus grand risque
provient du fait que bon nombre de plongeurs considèrent
ces ordinateurs comme la garantie universelle de leur sécurité
et dès lors s'autorisent toutes les fantaisies : multiples
plongées quotidiennes de préférence à profondeur
variable. Dans ces conditions d'utilisation, les règles
physiques et physiologiques de la plongée sous-marine sont
totalement bafouées : les accidents qui en résultent sont
donc bien souvent la traduction de l'ignorance des limites
d'emploi de ces appareils qui ne doivent rester que des
aides à la plongée.
Il
n'est pas facile d'estimer ce paramètre lorsque le retour
vers la surface se fait dans « le bleu », sans repères
visuels. L'expérience, la pratique régulière de la plongée
doivent résoudre cette difficulté. Cependant, dans la
recherche des causes de l'accident, cette remontée rapide
est difficile à mettre en évidence.
En
fait, l'expérience et l'analyse fine des circonstances des
accidents montrent que le dépassement de la vitesse de
remontée est un incident fréquent. Cette constatation a
d'ailleurs conduit les concepteurs de la table MN 90 à
conserver une vitesse de remontée jugée rapide par les
plongeurs : 17 m/mn. Et pourtant il s'agit d'un facteur de sécurité.
En effet, calculer une table de plongée avec une vitesse de
remontée de 15 m/min ou moins, favorise le risque,
lors d'une remontée plus rapide, de ne pas effectuer le
palier le plus profond que le calcul fait avec 17 m/mn
indique, alors que le calcul avec 15 m/mn peut (pour
certaines plongées de la tranche des 40/60 mètres) l'avoir
effacé. Paradoxalement, une vitesse de remontée à 17 m/mn
est donc une sécurité en imposant un palier
profond.
Les
plongées dites «Yo-Yo», c'est-à-dire effectuées avec
des variations de niveaux importants, sont suspectées de
faire subir aux bulles situées dans les capillaires
pulmonaires une sorte de recompression. Dans ces conditions,
leur réduction de volume peut favoriser leur passage sur le
versant artériel. Il faut toujours respecter
la procédure qui indique de redescendre au moins à
mi-profondeur pendant 5 minutes.
Une
hyperpression pulmonaire en cours de remontée, quel qu'en
soit le mécanisme (manoeuvre de Valsalva, gonflement de la
bouée à la bouche, toux, effort physique, apnée soit pour
«économiser» l'air, soit dans le cadre d'un exercice,
effort de vomissement en cas de mal de mer), peut être
responsable du passage de bulles d’azote dans le circuit
artériel. Les poumons se comportent comme un filtre vis à
vis des bulles d'azote car il les retient. Lorsque le
plongeur provoque l'augmentation de la pression dans ses
poumons et donc de la pression sanguine pulmonaire, il force
le filtre pulmonaire, d'où la dénomination d'hyperpression
pulmonaire. Ces bulles peuvent provoquer un accident
neurologique.
La
prévention de l'accident de plongée passe par le respect
des paliers, de la vitesse de remontée et des conditions
normales d’évolution sous-marine pour la plongée
sportive. Mais, une connaissance suffisante de la physique
et de la physiologie de la plongée doit permettre à
chacun, d'une part, de fixer ses limites et, d'autre part,
de comprendre que la plongée sous-marine autonome ne soit
pas sans risque, selon les tolérances que le plongeur
s'accorde.
Habituellement,
on incrimine un fléchissement de l'état général : un état
de fatigue chronique par manque de sommeil, surmenage
physique ou intellectuel est souvent retrouvé.
Dans
sa lutte contre le refroidissement, le plongeur va diminuer
l’irrigation des membres pour se concentrer sur les
organes vitaux. Le processus de désaturation va donc être
perturbé.
Lors
d’un effort pendant la plongée, la circulation sanguine
et la respiration vont s’accélérer augmentant la quantité
d’azote dissoute. Au palier, le plongeur étant au repos,
le temps de désaturation prévu par les tables ne sera pas
suffisant pour éliminer l’azote dissous pendant
l’effort. Les tables sont déterminées pour un « effort
moyen » qui n’est pas quantifiable car cela dépend des
capacités physiques de chaque plongeur.
L'azote
étant plus soluble dans les graisses que dans l'eau, l'excès
de tissus adipeux, plus que l'excès pondéral bien que les
deux soient très souvent liés, représente un « réservoir
» d'azote dissous à élimination lente qui n'est que
partiellement pris en compte par les tables de plongée. Si
des bulles se forment dans les graisses, elles passent
rapidement dans les veines et deviennent des bulles
circulantes.
Bien
qu'il soit communément admis qu'il n'y a pas de limite supérieure
d'âge pour plonger, il est toutefois nécessaire de prendre
en considération le fait qu'un bon nombre de victimes
d'accident neurologique chez lesquelles on ne retrouve
aucune erreur de procédure ont plus de 40 ans. En réalité,
ce sont davantage les maladies chroniques associées à l’âge
qui représentent des facteurs favorisants.
Auteur:
Stéphane
ROCHON
6-
Traitement et premiers secours
Un
accident de décompression dont les symptômes sont
apparemment bénins peut dégénérer très vite en accident
gravissime. Il est donc important d'agir vite et avec méthode.
De l’efficacité de l’encadrement dépend le sort du
malade. C'est pourquoi, lorsqu'un accident est suspecté,
que les symptômes soient franchement déclarés ou non, il
faut garder son calme et son sang-froid, en étant rassurant
pour le malade. Il faut rapidement administrer les premiers
soins suivant car le retard de mise en place des techniques
hyperbares et médicales spécialisées a souvent des conséquences
graves pour la victime et favorise les séquelles définitives
de l'accident :
- allongez
la victime dans une position confortable et retirez tout
élément pouvant gêner la circulation du sang (gants,
couteaux, instruments, boussole, manchons trop serrés...).
- donner de l'oxygène
en inhalation ou en insufflation à 15 l/mn. Le débit
d'02 pourra être modulé en fonction de la réserve
disponible, et de la durée de transport en bateau. Il
faut si possible maintenir un débit de 15 litres par
minute ( ne sera jamais toxique) pour éviter l’anoxie
tissulaire. La présence d'une mallette d'oxygénothérapie
est obligatoire dans tous les clubs de plongée et sur
le bateau.
- administrer
de l’aspirine à petite dose, 500 mg/24 heures, le
dosage étant de 5mg/Kg de poids corporel de la victime
avec maximum de 500mg en une seule prise, et en
respectant les contre-indications (allergie à
l'aspirine, antécédents d'ulcère gastro-duodénal).
L’admission se fera soit par voie orale, par exemple
un sachet d'ASPEGIC 500 ou de CATALGINE 500 simple à
diluer dans de l'eau plate, soit par voie intraveineuse
comme l’ASPEGIC 500 injectable. Ne jamais utiliser
d’aspirine effervescente. Ce traitement a pour objet
de minimiser l'agrégat plaquetto-cellulaire (caillots
sanguins autour des bulles pouvant provoquer des nécroses
locales). Attention, l’utilisation de l’aspirine
n’a pas d’effet magique. Certains pays ou structure
de plongée comme PADI déconseille l’utilisation
d’aspirine car il y a un risque de saignement.
- Auparavant
on indiquait aux moniteur qu’il fallait administrer 2
comprimés de SERMION qui est un vasodilatateur et 1
comprimé de TORENTAL qui allonge les globules rouges.
Ces médicaments ont pour objectif d’améliorer le
flux sanguin afin d’éliminer l’azote encore présent
et d’éviter les nécroses des tissus enfermant des
bulles. Ce traitement est désormais caduque. Il est
indiqué ici pour information.
- faire
boire de l'eau plate abondamment et par petites gorgées,
uniquement si le sujet est conscient, à raison d'un
litre en une heure afin augmenter la fluidité du sang.
De plus l’oxygène respiré est sec. S'assurer
auparavant qu'il peut uriner.
- effectuer
des soins de secourisme, selon le bilan ventilatoire et
cardiaque.
- relever
tous les paramètres de la plongée et des précédentes
s'il y a lieu et les placer avec la victime afin
d’informer le corps médical spécialisé.
- évacuer
le plus rapidement possible vers un centre médical
hyperbare. L’évacuation doit être systématique quel
que soit le type et le degré de l'accident, ne serait
ce que pour une simple mise en observation, un accident
de décompression peut toujours se compliquer.
En
cas d'accident de plongée, c'est le signal d'urgence
(PAN-PAN) qui doit être utilisé et non pas le signal de détresse
(MAYDAY) sur la VHF. Avant de passer votre message,
assurez-vous que la voie est libre et qu'aucune
communication n'est en cours (les appels au CROSS
peuvent également se faire directement sur les canaux 11
ou 13). Communiquez de la façon suivante sur le canal
16 :
- Répétez
trois fois PAN-PAN (prononcez panne-panne),
- Ici
"nom de votre bateau" (à répéter 3 fois),
- Répétez
le nom de votre bateau et donnez sa position,
- Décrivez
la nature de l'accident (en précisant qu’il s’agit
d’un accident de plongée),
- Faites
état des secours demandés (caisson, SAMU, pompiers...
),
- Précisez
l'endroit où vous vous rendez (port, plage, ponton) et
du temps de navigation estimé,
- Le
cas échéant, demandez des renseignements ou des
conseils d'ordre médical.
Auteur:
Stéphane
ROCHON

7-
Prévention
La meilleure des préventions
reste encore de prendre conscience que ce type d'accident n'épargne
personne. Pour éviter les risques d'un accident de décompression,
il faut respecter les points suivants :
- se conformer
scrupuleusement aux indications des tables et à la
vitesse de remontée,
- être sûr de son
instrumentation,
- ne jamais changer de
tables ou d'ordinateur lors de plongées successives,
- ne jamais effectuer de
manoeuvre de Valsalva pendant un palier de décompression
ou durant la remontée,
- ne pratiquer aucun
exercice d'apnée après une plongée en scaphandre,
- éviter de plonger en état
de fatigue,
- éviter les efforts trop
violents après une plongée,
- éviter tout abus
d'alcool et de tabac car ce sont des facteurs nocifs qui
fatiguent l'organisme,
- boire de l’eau après
la plongée et ne pas rester en plein soleil.
Auteur:
Stéphane
ROCHON
8-
Comparaison entre
Surpression Pulmonaire et
Accident de Décompression
| |
SURPRESSION
PULMONAIRE
|
ACCIDENT
DE DECOMPRESSION
|
| CAUSES |
Pression
trop forte dans les poumons (blocage de la glotte) |
Dégazage
d’azote |
| LOI
MISE EN JEU |
Mariotte |
Henry
& Mariotte |
| NATURE
DU GAZ MIS EN CAUSE |
Air |
Azote |
| PHYSIQUE |
Variation
relative de la pression |
Variation
de la pression |
| FACTEUR
TEMPS |
Indifférent |
Important |
| CONDITIONS |
Favorisé
par la proximité de la surface |
Dépend
du profil de la plongée (profondeur, durée,
effort...) |
| DELAI
D’APPARITION DES SYMPTOMES |
Immédiat |
0
à 12 heures (50% des cas dans la première ½
heure) |
| SYMPTOMES |
|
|
| COEUR |
Tachycardie
(>100 pulsations/mn), désamorçage artériel,
augmentation de la pression veineuse |
Tachycardie,
diminution de la pression artérielle et veineuse |
| POUMONS |
Respiration
difficile, crachats sanguins, pneumothorax |
Dyspnée
(respiration difficile) |
| DOULEURS |
Sous
claviculaire, thorax |
Musculaire,
articulaire |
| PERTE
DE CONNAISSANCE |
Syncope,
état de choc |
Syncope |
| PARALYSIE |
Hémiplégie,
paraplégie |
Toutes
formes de paralysie possibles |
| PEAU |
Emphysème
sous-cutané (air sous la peau) |
Puces,
moutons, bleuissement des extrémités |
| ATTITUDE |
Réflexes
rapides |
Fatigue,
ne réagit pas à la douleur |
| DIVERS |
Pâleur,
vertiges, angoisse, trouble de la vue et de l’ouïe |
Ramollissement
général, problèmes cardio-vasculaires |
| TRAITEMENT |
O2,
traiter l’état de choc, évacuation, caisson
envisageable |
O2,
aspirine £ 500 mg, eau, allonger , évacuation,
caisson |
| EVOLUTION |
Pas
d’évolution dans le temps |
Très
évolutif après les premiers symptômes |
| PREVENTION |
Souffler
en remontant, ne jamais bloquer sa respiration |
Respect
de la vitesse de remontée et des tables |
Auteur:
Stéphane
ROCHON


9-
Conclusion
Alors qu'en France le nombre
de personnes pratiquant la plongée sous-marine est en
constante augmentation, il semble que le nombre d'accidents
de plongée ne suivent pas cette progression et soit
actuellement stabilisé. Il faut y voir l'influence de la
formation technique dispensée dans les clubs, mais également
une meilleure connaissance, de la part des pratiquants, des
facteurs de risque et des circonstances favorisantes déclenchant
l’accident de décompression. Il faut donc continuer à
mieux former les plongeurs afin d’éviter les
comportements à risque qui ternissent l’image de ce
sport.
En règle générale,
si vous avez le moindre doute quant aux symptômes
concernant un accident de plongée, ne le prenez surtout pas
à la légère et administrez les premiers soins préconisés
pour l'accident de décompression. Mieux vaut toujours être
prudent et prévenant en la matière.
Auteur:
Stéphane
ROCHON
10-
Bibliographie
- Encyclopédie
de la plongée,
ouvrage collectif, édition VIGOT 1993
- Guide de préparation
au niveau IV,
Paul Villevieille, édition GAP 1995
- Théorie
et Plongée,
ouvrage collectif, FFESSM
1994
- Plongée
Passion,
P. Mioulane & J.M. Oyhenart, HACHETTE 1994
- La physique
appliquée à la Plongée,
J.C. Ripoll, Librairie des Plongeurs Editions
1989
Auteur:
Stéphane
ROCHON
|
|